Les enfants sont généralement exclus du droit de vote, à quelques exceptions près, comme dans les pays où la majorité électorale est fixée à seize ans. La raison principale est la croyance que les enfants n’ont pas les compétences nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause. Cependant, plusieurs éléments indiquent que l’abaissement de la majorité électorale à seize ans, voire à six ans ou zéro, pourrait être bénéfique non seulement pour les droits de l’enfant, mais également pour la représentation démocratique. Les écoles et les organismes de participation des jeunes, tels que les conseils nationaux de la jeunesse (CNJ), ont un impact significatif sur la participation politique des jeunes.

Le droit de vote des enfants en tant que droit de citoyenneté
Le droit de vote est un droit fondamental de la citoyenneté qui devrait s’étendre à tous les individus, y compris les enfants. Si les enfants sont affectés par des décisions politiques, ils devraient avoir leur mot à dire sur les personnes qui prennent ces décisions. Garantir l’inclusion démocratique signifie entendre toutes les voix, et pas seulement celles des adultes (Runciman, 2021).
L’émancipation des enfants n’est pas seulement bénéfique pour les droits de l’enfant, elle est également bonne pour la représentation démocratique. L’un des principes de la démocratie veut que toutes les personnes concernées par la décision collective aient leur mot à dire et puissent faire entendre leur voix dans le processus (Van der Straeten, Runciman, 2023).
Si l’on affirme que les enfants ne partagent pas à la vie de la communauté de la même manière que les adultes, parce qu’ils ne gagnent pas d’argent, ne paient pas d’impôts, ou n’exercent pas de fonction publique, il est important de souligner que ces conditions préalables à l’émancipation ont été abandonnées il y a longtemps.
Aujourd’hui, les adultes votent indépendamment du fait qu’ils paient des impôts, qu’ils contribuent aux services publics ou qu’ils dépendent de l’aide de l’État. Le droit de vote ne dépend pas des contributions individuelles, mais est plutôt ancré dans les expériences partagées qui nous lient en tant que membres de la société (Runciman, 2021).
La majorité électorale dans le monde
Les enfants sont généralement exclus du droit de vote, au motif qu’ils ne sont pas assez mûrs pour prendre des décisions raisonnées et autonomes. Cependant, cette approche a été remise en question ces dernières années et certains États reconnaissent aujourd’hui le droit de vote aux personnes âgées de moins de dix-huit ans (FRA, 2017).
Majorité électorale à seize ans
Au Nicaragua, en Écosse, à l’île de Man, à Guernesey, en Éthiopie, en Équateur, à Cuba, au Brésil et en Autriche, la majorité électorale légale est de seize ans. De plus, en Estonie et à Malte, les enfants ont le droit de voter aux élections locales dès l’âge de seize ans, et il en va de même pour les élections locales et régionales dans certaines régions d’Allemagne (Länder) et du Royaume-Uni (Écosse) (FRA, 2017). La Belgique a été le dernier pays de l’UE à introduire une loi étendant le droit de vote aux élections européennes aux jeunes de seize et dix-sept ans (Elections Europa, 2024).
Majorité électorale à dix-sept ans
Les pays où la majorité électorale est fixée à dix-sept ans sont le Soudan, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, l’Indonésie, la Grèce et le Timor oriental. Même si la majorité électorale est de dix-sept ans en Indonésie, les personnes mariées sont tenues de voter quel que soit leur âge (WorldAtlas, n.d.).
Majorité électorale à dix-huit ans
Dans la plupart des pays, la majorité électorale est fixée à dix-huit ans. Plus de cent pays font partie de cette catégorie, dont l’Afghanistan, la Chine, l’Australie, les Bahamas, la Belgique, le Botswana, le Canada, les Comores, le Danemark, l’Égypte, la Finlande, la France, la Géorgie, l’Allemagne, le Guatemala, l’Israël, la Jamaïque, la Jordanie, le Liban, les Îles Marshall, la Macédoine, la Mauritanie, le Kenya, la Mongolie, les Philippines, Sainte-Hélène, la Tanzanie, les États-Unis, le Yémen, le Zimbabwe, le Japon, l’Italie et bien d’autres (WorldAtlas, n.d.).
Majorité électorale à dix-neuf ans
La Corée du Sud est le seul pays dans lequel la majorité électorale est fixée à dix-neuf ans (WorldAtlas, n.d.).
Majorité électorale à vingt ans ou plus
Les pays dont la majorité électorale est de vingt ans sont Nauru, Taïwan et Bahreïn. En revanche, les États où l’on peut voter à partir de 21 ans sont Oman, Samoa, Tokelau, Tonga, Singapour, la Malaisie, le Koweït, Jersey et le Cameroun. Les Émirats arabes unis détiennent l’âge légal de vote le plus élevé au monde. Les citoyens ne peuvent voter que lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 ans (WorldAtlas, n.d.). L’Italie a fixé à 25 ans l’âge requis pour voter au Sénat (FRA, 2017).
Les arguments en faveur de l’abaissement de la majorité électorale
Les opposants à cette idée affirment que les enfants n’ont pas les compétences nécessaires pour prendre des décisions éclairées, mais de nombreux adultes ont également du mal à comprendre la complexité de la politique, ce qui rend incohérent le fait de fixer des normes plus élevées pour les enfants (Van der Straeten, Runciman, 2023).
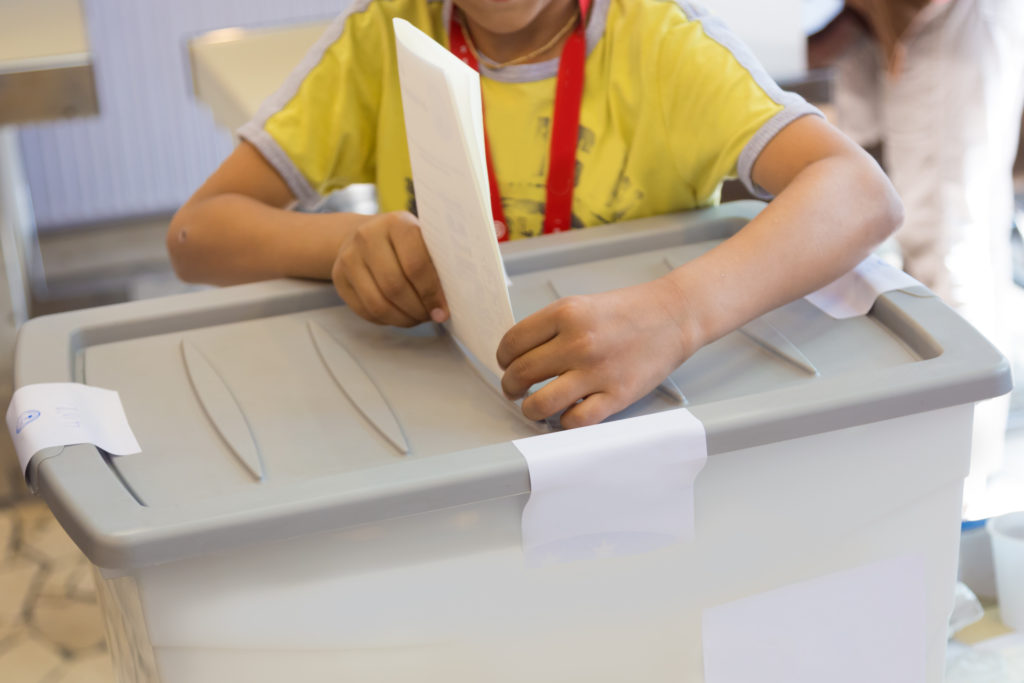
Le vote est lié à des responsabilités telles que le paiement d’impôts, l’exercice d’une fonction et la participation à des jurys, des droits dont les enfants sont exclus bien qu’ils soient soumis à des lois (Van der Straeten, Runciman, 2023). Contrairement à l’émancipation des femmes, l’objectif n’est pas que les enfants exercent des fonctions, mais qu’ils puissent faire entendre leur voix (Van der Straeten, Runciman, 2023).
Les recherches menées par Mark Franklin soulignent que la première expérience de vote d’un individu influence son engagement futur, ce qui rend le vote à un jeune âge essentiel pour favoriser la participation civique à long terme. Selon lui, les adolescents âgés de quinze ou seize ans sont mieux placés pour voter que les adolescents plus âgés, car ils sont davantage ancrés dans des réseaux de soutien et des environnements structurés comme l’école (Van der Straeten, Runciman, 2023).
De plus, des études montrent que les enfants se préoccupent davantage des questions environnementales qui les touchent plus directement, comme les conséquences de la mode rapide (Runciman, 2021). Les jeunes s’engagent activement dans des initiatives et des manifestations pour le climat, plaidant pour des changements de politique, des changements dans les habitudes de consommation et des solutions plus vertes. Les inclure dans le discours politique garantirait que leurs priorités sont représentées dans la société, renforçant ainsi la démocratie.
Voter à l’âge de six ans ou même zéro ?
David Runciman, professeur de politique à l’université de Cambridge, plaide pour l’abaissement de la majorité électorale à six ans. Selon lui, six est un beau chiffre rond qui correspond à l’âge auquel les enfants commencent l’école. Il ne s’agit pas d’un âge de compétence, mais plutôt d’une capacité à rejoindre l’école, qu’il considère comme le seuil minimal à atteindre (Van der Straeten, Runciman, 2023).
« Je viens de passer les derniers mois à travailler dans une école primaire à Cambridge avec des enfants, discutant avec eux non pas de citoyenneté ou d’autres choses de ce genre, mais simplement de leur attitude face au fait qu’ils n’ont pas le droit de voter. Ce que j’ai surtout retenu, c’est que l’école est en fait un endroit idéal pour intéresser les enfants, même ceux de six ans, à la politique démocratique. C’est un endroit sûr, c’est une expérience vivante et amicale pour les enfants (…). Les enseignants et l’éducation représentent un bon cadre pour la politique démocratique.»
– David Runciman (Van der Straeten, Runciman, 2023).
Jonathan Bernstein, politologue, a proposé une autre option : abaisser la majorité électorale à zéro et considérer le droit de vote comme un droit de l’homme ou un droit de naissance. Cependant, cela serait extrêmement compliqué, car les très jeunes enfants n’ont ni la compétence ni la capacité physique d’exprimer leur vote. Dans ce cas, ce serait aux parents de voter pour eux, ce qui impliquerait l’utilisation de systèmes de procuration pour filtrer le droit de vote (Van der Straeten, Runciman, 2023).
De plus, la plus grande question qui se pose est que permettre à un parent de voter pour son enfant va à l’encontre du principe « une personne, une voix » (Crippes, 2011). Par conséquent, même si le droit de vote est considéré comme un droit fondamental, ses implications pratiques empêchent de le considérer comme un droit inhérent à la naissance. Cet aspect exige des gouvernements qu’ils fixent un âge minimum pour exercer le droit de vote, lié à un ensemble minimum de compétences et de connaissances que les enfants devraient avoir pour exprimer leur point de vue.
Les conséquences de l’abaissement de la majorité électorale
Les données disponibles sur les conséquences de l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans sont limitées, car peu de cycles électoraux se sont écoulés depuis que les pays ont adopté cette approche. Toutefois, les premières données disponibles sont assez cohérentes.
Des études portant sur les élections municipales aux États-Unis et les élections nationales en Autriche montrent que les jeunes de seize et dix-sept ans participent activement à la vie politique et que le fait de voter à un jeune âge précoce crée une routine électorale. Socialisés dans une culture de participation politique, les électeurs de seize ou dix-sept ans peuvent devenir plus actifs politiquement plus tard que ceux qui ne votent pas avant l’âge de dix-huit ou dix-neuf ans (The Body Shop, 2022).
En Autriche, l’un des premiers pays à avoir abaissé la majorité électorale en 2007, le taux de participation des jeunes a augmenté. Cette tendance s’accompagne d’une confiance croissante dans les processus démocratiques. Les habitudes de vote des moins de dix-huit ans s’alignent désormais sur celles des personnes plus âgées. Cela indique que les jeunes ont la volonté, les connaissances et la capacité de s’engager dans des choix politiques difficiles, et que l’abaissement de la majorité électorale n’est pas lié à la politique d’un parti spécifique (The Body Shop, 2022).
Il existe également un risque lié au fait que les jeunes sont susceptibles d’être facilement manipulés par des adultes, tels que des politiciens ou leurs parents. Cependant, les faits confirment que les jeunes sont enthousiastes et intéressés par le monde dans lequel ils vivent, et que l’abaissement de la majorité électorale soutiendra davantage leur participation active. L’élargissement du corps électoral aux jeunes de plus de seize ans rendra la prise de décisions politiques plus justes, plus inclusives et plus représentatives de l’ensemble de la population.
Par où commencer ? Le rôle des écoles
Les enfants ne sont pas à l’abri de la politique. Bien qu’elle doive être tenue à l’écart des écoles, l’environnement dans lequel vivent les enfants est constitué de modèles adultes qui discutent et vivent des conséquences de la politique. Il est donc impossible de tenir les enfants à l’écart de la politique, mais il est important de leur donner les outils nécessaires pour naviguer dans cet aspect de la vie. L’introduction de la politique dans les écoles n’aggraverait pas la situation des écoles, au contraire, elle améliorerait la politique, car la protection des enfants est sérieusement prise en compte dans ces contextes (Runciman, 2021).

L’environnement scolaire est un lieu sûr où les enfants peuvent exprimer leurs points de vue et leurs opinions en toute sécurité et développer des compétences et des connaissances en fonction de leur âge et de leurs capacités. Il est important de leur donner l’occasion de parler davantage de politique et de se forger une opinion indépendante. Pour cela, il faudrait changer radicalement le système d’enseignement, car dans de nombreux pays, dont la France, les enseignants ne sont pas autorisés à parler de politique en classe (Van der Straeten, Runciman, 2023).
L’éducation civique est un moyen important de faciliter la connaissance du fonctionnement des institutions publiques. Si l’on attend des jeunes qu’ils s’engagent politiquement, il est essentiel qu’ils reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin.
Une étude récente sur la baisse de l’engagement politique aux États-Unis montre que les écoles ont une influence significative pour faciliter l’acquisition de connaissances pertinentes grâce à des cours d’éducation civique qui expliquent le fonctionnement des institutions publiques en ancrant les valeurs et les principes démocratiques chez les jeunes dès le plus jeune âge (The Body Shop, 2022).
Cependant, tout le monde n’a pas accès aux mêmes opportunités, ce qui place les jeunes déjà marginalisés dans une situation plus désavantageuse. Cela concerne les jeunes femmes et les filles, les jeunes porteurs d’un handicap, les jeunes autochtones et ceux qui vivent dans des zones rurales ou des territoires touchés par des crises (The Body Shop, 2022).
Participation significative des jeunes à tous les niveaux
Aujourd’hui, les décisions qui affectent la vie des jeunes sont prises au niveau local, national et mondial. La mise en place de mécanismes indépendants et durables de participation des jeunes, fondés sur des questions précises, peut avoir une influence positive sur la participation électorale des jeunes en général et contribuer à lever les obstacles auxquels se heurtent les jeunes candidats à la politique (The Body Shop, 2022).
Niveaux local et national
Les conseils nationaux de jeunesse (CNJ) ont un impact significatif en facilitant la participation politique des jeunes au niveau national, en servant de lien entre les jeunes et les responsables politiques. Composés principalement d’organisations de jeunesse, de syndicats étudiants et de parlements nationaux de jeunes, ces conseils sont parfois officiellement reconnus par le gouvernement national comme l’un des principaux moyens d’intégrer le point de vue des jeunes dans les décisions gouvernementales importantes.
Dans certains cas, les responsables politiques préfèrent travailler avec les représentants des jeunes des CNJ, en raison de leur légitimité et de leur caractère représentatif. Ils ne représentent non seulement les jeunes, mais également les organisations de jeunesse (The Body Shop, 2022).
Il est important de ne pas négliger le niveau local lorsqu’on cherche à augmenter la participation des jeunes dans la prise de décisions politiques. Tout comme au niveau national, la participation locale des jeunes dans ce domaine peut être diverse, reflétant les problèmes locaux, les mécanismes de participation et l’accès aux ressources (The Body Shop, 2022).
Niveau international
La participation politique des jeunes ne se limite pas aux frontières nationales. Les institutions internationales et intergouvernementales, telles que les Nations unies (ONU), le Conseil de l’Europe, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Union européenne, entre autres, prennent des décisions qui peuvent, dans des circonstances idéales, influencer la vie des jeunes. Mais pour les jeunes, participer à ces forums peut s’avérer beaucoup plus complexe que de participer près de chez eux (The Body Shop, 2022).
Les organisations et mouvements internationaux de jeunesse, tels que les Scouts, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Forum européen de la jeunesse, la grève étudiante pour le climat, la Réunion internationale de coordination des organisations des jeunes (ICMYO), et bien d’autres, soutiennent la participation en servant d’intermédiaires entre les jeunes et ces institutions.
Les branches nationales de ces organisations contribuent également à réduire l’écart entre les niveaux local et international. De plus, elles sont bien équipées pour fournir aux jeunes les connaissances et le soutien nécessaires pour participer à des institutions politiques internationales complexes et potentiellement intimidantes (The Body Shop, 2022).
Les mesures à prendre pour que les enfants soient entendus dans la politique
Pour faire progresser les droits et les besoins des jeunes et s’assurer qu’ils soient entendus de manière significative dans la vie publique et dans la prise de décision, il convient de soutenir les efforts visant à promouvoir les changements de politique et de législation (The Body Shop, 2022).

Par exemple, en mai 2022, le Parlement européen a présenté une proposition de règlement du Conseil portant sur l’élection des membres du Parlement européen (MEP) au suffrage universel direct et a proposé d’abaisser la majorité électorale à seize ans, même si cela permet des exceptions pour « les ordres constitutionnels existants établissant un âge minimum de vote de dix-huit ou dix-sept ans » (Voting age, 2024, UE).
Les ONG ainsi que les organisations de la société civile (OSC) réclament également ce changement depuis des années. Par exemple, le Forum européen de la jeunesse a fortement plaidé en faveur de l’abaissement de la majorité électorale à seize ans pour les élections locales, nationales et européennes, et pour réduire l’écart entre les jeunes générations et nos hommes politiques élus (Forum européen de la jeunesse, 2024).
Concrètement, la mise en œuvre de programmes complets d’éducation civique pour les jeunes et l’établissement de mécanismes formels, transparents et diversifiés de participation des jeunes aux niveaux local, national et international pourraient promouvoir les intérêts et les besoins des enfants et des jeunes par le biais de leurs propre voix (The Body Shop, 2022).
Rédigé par Arianna Braga
Traduit par Victoire Ramos
Relu par Aditi Partha
Dernière mise à jour le 19 janvier 2025
Bibliographie:
Crippes N. (2011). What if the Right to Vote Started at Birth? Retrieved from Fair Vote at https://fairvote.org/what-if-the-right-to-vote-started-at-birth/, accessed on 19 January 2025.
EU, Voting age (2024). Voting age for European elections. Retrieved from European Parliament at https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/749767/EPRS_ATA(2023)749767_EN.pdf, accessed on 4 April 2024.
European Youth Forum (2024). Vote at 16. Retrieved from European Youth Forum at https://www.youthforum.org/topics/vote-at-16, accessed on 4 April 2024.
FRA (2017). Children’s right to vote. Retrieved from Fundamental Agency for Fundament Rights (FRA) at https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/childrens-right-vote, accessed on 30 January 2024.
Runciman, D. (2021). Votes for children! Why we should lower the voting age to six. Retrieved from The Guardian at https://www.theguardian.com/politics/2021/nov/16/reconstruction-after-covid-votes-for-children-age-six-david-runciman, accessed on 30 January 2024.
The Body Shop (2022). Be Seen Be Heard. Understanding young people’s political participation. The research paper is commissioned by The Body Shop in collaboration with and with technical assistance from the United Nations Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth. Retrieved from the European Youth Forum at https://www.youthforum.org/files/UPDATED_UN_REPORT_TBS_Accessible_Version_090622.pdf, accessed on 30 January 2024.
Van der Straeten, K., Runciman, D. (2023). Should children have the right to vote? (Transcript). Retrieved from Bennett Institute for Public Policy at https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/blog/should-children-have-the-right-to-vote/, accessed on 30 January 2024.
WorldAtlas (n.d.). Legal Voting Age by Country. Retrieved from WorldAtlas at https://www.worldatlas.com/articles/legal-voting-age-by-country.html, accessed on 30 January 2024.

